Genre
FILM MUSICAL
Nationalité
États-Unis231
Durée : 2h11
Date de sortie en France : 18/06/2014
Date de sortie en France : 18/06/2014
Réalisation
:
Clint EASTWOOD
Inspiration
:
D'après une comédie musicale de Marshall BRICKMAN et Rick Elice
Prise de vues
:
Tom STERN
Musique
:
Bob GAUDIO
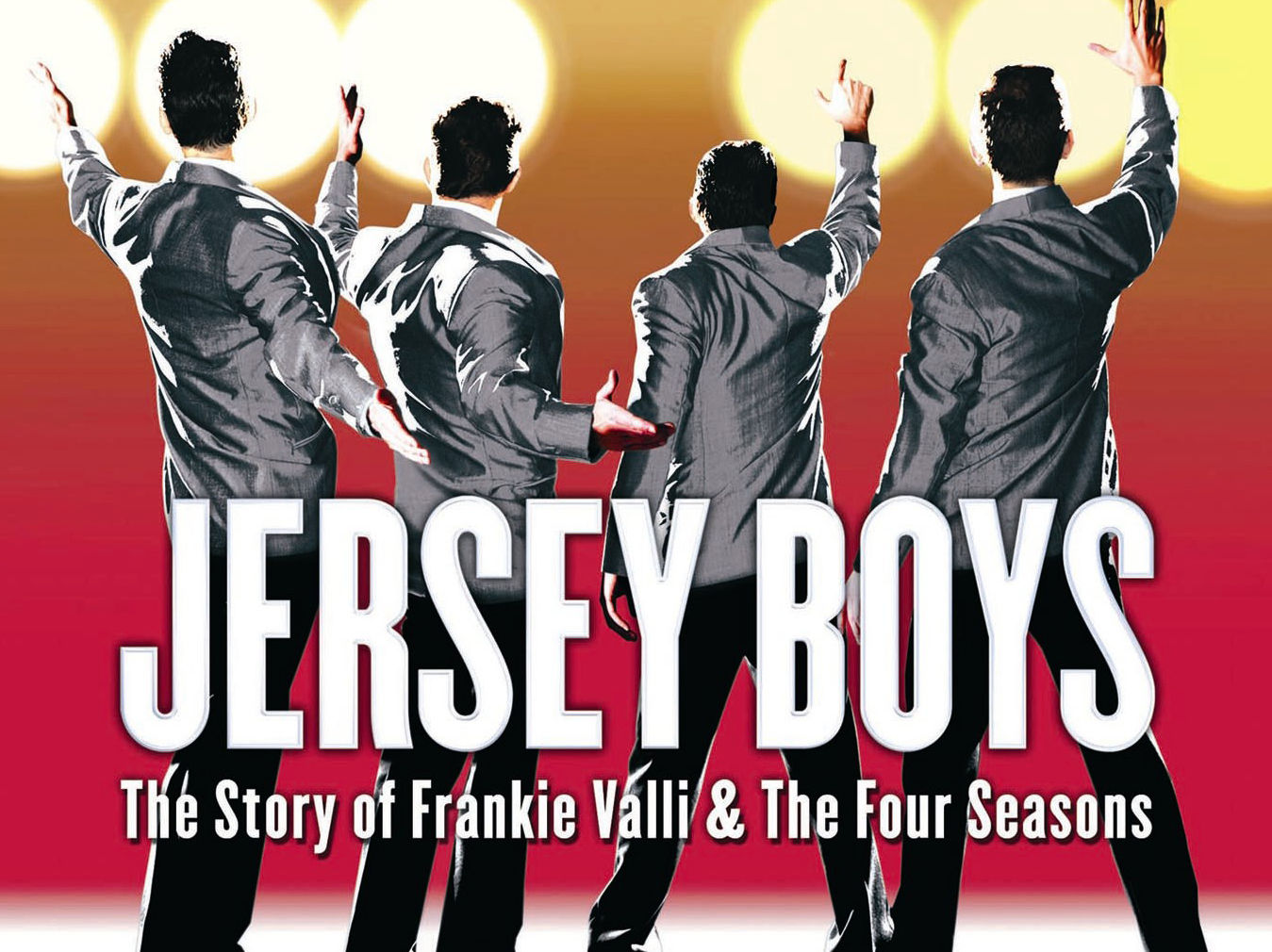
Interprétation
Distributeur : Warner Bros Pictures France
Résumé
Quatre garçons de l'état du New Jersey, issus d'un milieu plutôt modeste, montent le groupe "The Four Seasons" qui deviendra rapidement mythique dans les années 1960. Leurs épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les tubes emblématiques de toute une génération qui sont repris aujourd'hui par tous les fans de la comédie musicale.
Source : Matériel de presse
Critique
Critiques - Commentaires Public
8175
Critique de
Maxime Stintzy
Inoffensifs et rafraîchissants, les « wap doo wap » pur sucre de ces quatre garçons d’avant, sapés avec soin, synchrones et toujours propres sur eux ? De prime abord, oui, surtout quand on les compare à nos boys bands abâtardis d’après, aussi éphémères qu’ils demeurent, eux, les survivants octogénaires aux cent millions de galettes vendues, statufiés depuis 1990 dans le Rock and Roll Hall of Fame. Or c’est bien l’ombre d’un autre Frankie et donc, en coulisse, celle de la mafia italo-new-yorkaise qui plane et pèse sur l’instable ascension, puis la dispersion brutale, plutôt contrite, du quatuor des Four Seasons (appellation volée en 1960 à l’enseigne d’un bowling peu accueillant, pour s’affranchir des Variationes, desTopics et des Four Lovers qui la précédèrent). Sinatra, en effet, hante leurs rêves de jeunes ritals plébéiens et turbulents ; il anime tout naturellement leurs conversations et aura même donné son nom à la première suite de palace qu’ils investiront. Mieux encore : n’a-t-il pas suscité chez le petit Francesco Castelluccio sa vocation de chanteur vedette lorsqu’à sept ans celui-ci était allé l’entendre avec sa mère au Paramount Theater de la Grande Pomme voisine ? Un épisode clef auquel il ne nous est en revanche pas donné d’assister, faute, peut-être, d’une assez probante incarnation disponible du crooner de référence. Car, au cours de ses trois biopics antérieurs et jusque dans celui-ci, Clint Eastwood n’a – qu’on leur préfère ou non ses fictions – du moins jamais transigé sur la nécessaire ressemblance de ses interprètes avec leurs illustres modèles : Forest Whitaker, d’ailleurs primé à Cannes pour Bird (1988) ; Morgan Freeman, dont le troublant Nelson Mandela d’ Invictus (2009) l’emporte sur Dennis Haysbert (2007)ou le récent Idris Elba (2013) ; Leonardo DiCaprio, Hoover torturé et grimé à souhait en J. Edgar (2001). Non moins attentif cette fois à la concordance des chiffres, semble-t-il, le cinéaste célèbre par son 34e opus les quatre-vingts ans d’un artiste précisément né en 1934. Fort différent de lui a priori, le futur Frankie Valli y devient au demeurant, sur un mode quasi hagiographique et par contraste avec ses trois partenaires de scène, l’idéal support de projection des valeurs et des tourments personnels qui l’animent : ce personnage rigoureux, stoïque et sacrificiel (lequel s’épuisera en tournées ingrates pour éponger les dettes inconsidérées de son moins reluisant ami), mais aussi volage, trop absent du foyer sans doute et, comme le Gus d’Une Nouvelle Chance (le dernier rôle d’Eastwood en 2012, sous la direction de son fidèle coproducteur Robert Lorenz), en tendre conflit avec sa fille envolée (Francine Valli, la favorite mal accompagnée qui, échouant à prendre « la relève », mourra d’une overdose à New York en 1990). Fils d’un modeste barbier de Newark, le chanteur en herbe au falsetto ravageur eût pour sa part relayé son père si, vers vingt-trois ans, il n’avait pas été poussé derrière un micro, sur la scène des petits clubs locaux, par son compagnon d’incivilités, hâbleur et un tantinet voyou, Tommy DeVito (du Variety Trio) – l’incontestable fondateur du groupe (et son dynamiteur, hélas ! ) auquel il sauvera la mise, une dizaine d’années plus tard, en apaisant la vindicte de la pègre à son égard (le fêtard finira échoué sous étroite surveillance à Las Vegas). Les rejoindront, chemin faisant, un autre copain d’enfance, le bassiste Nick Massi (aux beaux accents caverneux) et surtout, issu du Bronx et seul étranger au Jersey, leur pianiste et providentiel compositeur Bob Gaudio, puceau guindé qu’ils s’emploieront à déniaiser. Ce dernier s’avère avec Bob Crewe, parolier et producteur gay façon Liberace, le cosignataire de tous les grands tubes qui jalonnent leur assez brève trajectoire en pain de sucre – de « Sherry » (1962) au grandiose « Can’t Take My Eyes Off You » (1967), alors inespéré – et nourriront à Broadway en 2005, avant sa présente adaptation cinématographique, le musical homonyme Jersey Boys (déjà écrit par Marshall Brickman et Rick Elice), lauréat très rétro de 6 Tony Awards. Est-il besoin de rappeler que, féru de musiques américaines depuis ses débuts derrière la caméra (sans « Misty » d’Erroll Garner, pas de Frisson dans la Nuit pour lui, en 1971 !), le réalisateur inspiré du bouleversant Honkytonk Man (1982) y avait campé, deux décennies après son album de « Cowboy Favorites », un authentique country singer à l’agonie, qu’il tâte volontiers du piano jazz et crée, depuis le « Claudia’s Theme » d’Impitoyable (1992), les sobres motifs mélodiques de la plupart de ses films ? Nous ne devrons donc pas nous étonner de l’aisance qu’il déploie dans les élégantes séquences chantées, qu’interprètent en live ses quatre comédiens inconnus à l’écran, quoique charmeurs et bien typés (Vincent Piazza, Michael Lomenda, Erich Bergen et – durable sosie de Frankie Valli – le parfois poignant John Lloyd Young, créateur du rôle au théâtre), sur des chorégraphies millimétrées de Sergio Trujillo. Sans cuillérées de sirop inutiles, elles se révèlent d’autant plus goûteuses qu’elles se bornent aux performances scéniques du groupe, puis à un ballet de rue final certes conventionnel, mais digne de Jerome Robbins et qui permet à Christopher Walken, l’unique star au générique (en seigneuriale éminence grise du « milieu »), de renouer fugitivement avec sa formation de danseur. Hasard ou clin d’œil volontaire ? L’insondable acteur, violoncelliste parkinsonien d’un autre brillant Quatuor (réuni et déchiré par Yaron Zilberman en 2012) avait en l’occurrence entonné le hit ultime de Frankie Valli (« Can’t Take My Eyes Off You », cité plus haut) dans ce Voyage au bout de l’enfer (1979) qui le distingua sous la férule de Michael Cimino. Une seconde référence de cinéphile, explicite celle-là, nous a laissé davantage perplexe : le film attribue la genèse de la chanson « Big Girls Don’t Cry » à la gifle reçue par Jan Sterling de Kirk Douglas dans Le Gouffre aux chimères de Billy Wilder (aperçu à la télé), alors qu’elle avait été flanquée, dit-on, par John Payne à Rhonda Fleming dans Tennesse’s Partner, un western d’Allan Dwan avec Ronald Reagan (jadis soutenu par l’ex-maire de Carmel). Les scénaristes ont peut-être eu tort, par ailleurs, de maintenir une narration alternée à quatre voix, bonne idée dramaturgique mal compatible ici avec de fréquents flottements de points de vue : à tour de rôle, les membres des Four Seasons s’y adressent au spectateur, face caméra, puis s’absentent sans raison ni logique, échouant ainsi à renforcer la complicité recherchée (seul s’impose un temps, au départ, le Tommy DeVito campé par Vincent Piazza, grâce à son arrogance cynique de jeune coq). Agacent en outre de grossiers anachronismes lexicaux, plutôt incongrus chez Clint Eastwood. Est-ce parce qu’ils tiennent, à leur niveau, du « Rat Pack » (Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr, Peter Lawford et Joey Bishop) et qu’ils ont croisé, adolescents, le brutal « affranchi » Joe Pesci (natif de Newark lui aussi) qu’ils gagnent à se définir en « fucking team » ? Parce que leur nom collectif d’artistes pourrait prêter à confusion qu’il leur faut éructer « Fuck Vivaldi » (bien plus obscène que le fameux « Roll on Beethoven » de Chuck Berry en 1956)? On aimait le héros taciturne de Sergio Leone et Don Siegel quand il les concurrençait dans leur fauteuil ; on l’aime beaucoup moins quand il s’avise d’empiéter sur le territoire réservé de Scorsese où il n’a que faire. Ses moments de petite délinquance juvénile, ses joutes conjugales et ses longs conciliabules mafieux constituent du reste les autres points faibles de ses Jersey Boys, trop démonstratifs alors pour convaincre tout à fait. Au-delà de leurs atouts très spécifiques, on sera néanmoins sensible à la somptueuse reconstitution des sixties naissantes (où la Cadillac Eldorado Biarritz, modèle cabriolet de 1959, précède en majesté la Ford Gran Torino de1968), à quelques retours au mélo joliment négociés et à la révélation, dans la reprise du rôle de Maria Delgado (épouse Valli), d’une vraie nature de comédienne, pleine d’aplomb et de sensualité : Renée Marino, dont la première apparition cinématographique n’est pas sans rappeler, la coiffure et la robe décolletée aidant, la redoutable Rita Hayworth. Lorsque, contraint d’entamer une carrière solo au rabais, Frankie, dans un café, se laisse aller à lâcher un terrible « Pourquoi tout le monde s’en va ? », on ne peut enfin s’interdire d’y percevoir un écho à la situation personnelle de Clint, 84 ans. S’il ne semble pas prêt de raccrocher (préparant pour l’heure un très guerrier American Sniper, nouveau biopic incarné par Bradley Cooper), ni de s’écarter des siens (sa fille Francesca apparaît en serveuse dans Jersey Boys, son fils Kyle en a livré la discrète musique additionnelle), détresse et gravité affleurent là, au cœur de son propos, mais sans nuire à l’« entertainment » attendu. Dans le même genre, il devait d’abord livrer un second remake de l’emblématique A Star Is Born, torpillé par l’abandon de Beyoncé. Avec autant de nostalgie, probablement, que de touchante ironie, il choisit ici de se montrer un court instant sur le petit écran, en noir et blanc (comme, du reste, le sigle de la Warner Bros qui ouvre la séance) : il y est redevenu, par la magie de quelques images animées, le cow-boy récurrent de Rawhide (216 épisodes entre 1959 et 1965), témoin direct de l’ascension des Four Seasons et comme eux toujours vivant aujourd’hui. Ne serait-ce pourtant pas sa façon à lui, pudique et distante, de se demander – de nous demander – qui est le fantôme de l’autre ?
Bibliographie
- Positif n° 641/642 (juillet 2014)
- FICHE de Monsieur Cinéma
- Libération 18/06/2014
- Le Canard Enchainé 18/06/2014